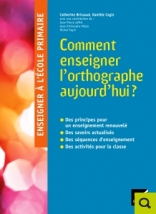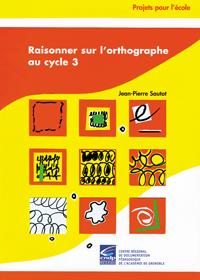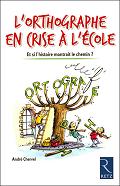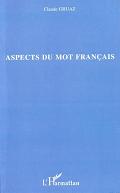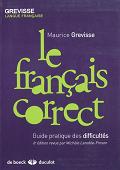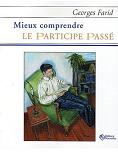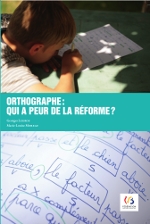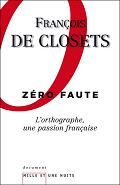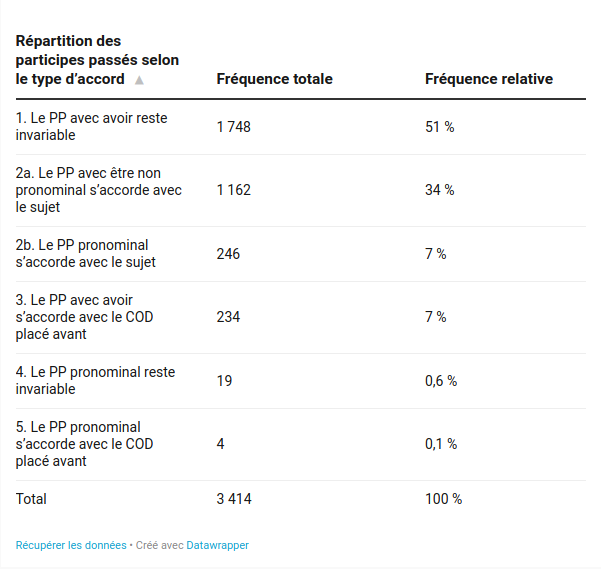Pédagogie & didactique
Linguistique
Sociologie et sociolinguistique
Réforme
Dictionnaires
Pédagogie & didactique
Encore un petit tour de graphèmes ?
Quelques réflexions en hommage à JCP », 267‑279, In Dans la carrière des mots. Mélanges offerts à Jean-Christophe Pellat. Textes réunis par Nathalie Gettliffe & Jean-Paul Meyer. Université de Strasbourg.
Du prescrit au réel en CM2 : l’accord sujet-verbe dans le corpus Grenouille
in Cecilia Gunnarsson-Largy et Emmanuèle Auriac-Slusarczyk (dir.), Écriture et réécritures chez les élèves. Un seul corpus, divers genres discursifs et méthodologies d’analyse. Louvain-la-Neuve : Academia.
La révision orthographique au CM2 : l’accord sujet-verbe dans le corpus Grenouille
in Cecilia Gunnarsson-Largy et Emmanuèle Auriac-Slusarczyk (dir.), Écriture et réécritures chez les élèves. Un seul corpus, divers genres discursifs et méthodologies d’analyse. Louvain-la-Neuve : Academia.
Comment rendre efficace l’enseignement de l’orthographe ?
Catherine Brissaud, Danièle Cogis, Jean-Pierre Jaffré, Jean-Christophe Pellat, Michel Fayol, Hatier, 2011, 320 pages
Commander sur le site de l’éditeur
La dictée, un exercice
- Sautot J.-P. (2015), « ? » In La lettre de l’AIRDF, n° 57. pp. 25 à 33.

Consultable en ligne : www.persee.fr/doc/airdf_1776-7784_2015_num_57_1_2034
Orthographier
- M. Fayol & J.-P. Jaffré, Presses universitaires de France, 2008, 232 p.
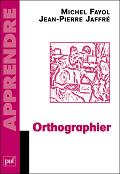 L’orthographe du français, parce qu’elle est l’une des plus complexes au monde, fait régulièrement l’objet de débats sur les avantages et les inconvénients de cette complexité et sur les mérites comparés des méthodes d’apprentissage, anciennes comme nouvelles. Pourtant, ces échanges tiennent rarement compte des travaux scientifiques les plus récents qui nous apprennent à mieux comprendre les causes d’une telle complexité et les problèmes qui en découlent pour son acquisition. Il est vrai que ces travaux sont le plus souvent publiés en anglais, dans des revues ou des ouvrages difficilement accessibles.
L’orthographe du français, parce qu’elle est l’une des plus complexes au monde, fait régulièrement l’objet de débats sur les avantages et les inconvénients de cette complexité et sur les mérites comparés des méthodes d’apprentissage, anciennes comme nouvelles. Pourtant, ces échanges tiennent rarement compte des travaux scientifiques les plus récents qui nous apprennent à mieux comprendre les causes d’une telle complexité et les problèmes qui en découlent pour son acquisition. Il est vrai que ces travaux sont le plus souvent publiés en anglais, dans des revues ou des ouvrages difficilement accessibles.
Ce livre a donc pour but de mettre une information nouvelle à la disposition de lecteurs francophones intéressés par ces questions, pour des raisons professionnelles ou personnelles. Il y apprendront ainsi que la forme actuelle de l’orthographe du français est le résultat d’une histoire qui n’est pas un long fleuve tranquille et qu’il ne suffit pas d’apprendre des règles pour espérer en maîtriser les particularités. Ils y apprendront aussi que les difficultés relèvent de domaines différents – phonographie, lexique, morphologie – qui ne peuvent être traités de manière semblable. Se posent alors les questions de l’apprentissage et de la mise en œuvre des habiletés relatives à chacun de ces domaines, avec en perspective, les interventions possibles pour améliorer les performances et les connaissances.
Commander dans une librairie en ligne
Réussir à apprendre
- G. Chapelle & M. Crahay (dir.), Presses universitaires de France, 2009, 248 p.
 Le quotidien des enseignants, c’est la diversité des élèves. Avec pour tous le même objectif : réussir à apprendre. Le paradoxe de l’enseignement est là. Les élèves sont différents et, pourtant, l’enseignant se doit d’avoir, pour tous, la même ambition : les accompagner au plus loin sur les chemins de l’apprentissage. Cette mission ne s’apparente-t-elle pas à une tâche insurmontable ? Sans naïveté sur les difficultés que cela représente, cet ouvrage offre par ses différentes contributions, appuyées sur la recherche scientifique internationale, une réflexion sur la meilleure manière de faire surmonter aux élèves les obstacles qui surviennent.
Le quotidien des enseignants, c’est la diversité des élèves. Avec pour tous le même objectif : réussir à apprendre. Le paradoxe de l’enseignement est là. Les élèves sont différents et, pourtant, l’enseignant se doit d’avoir, pour tous, la même ambition : les accompagner au plus loin sur les chemins de l’apprentissage. Cette mission ne s’apparente-t-elle pas à une tâche insurmontable ? Sans naïveté sur les difficultés que cela représente, cet ouvrage offre par ses différentes contributions, appuyées sur la recherche scientifique internationale, une réflexion sur la meilleure manière de faire surmonter aux élèves les obstacles qui surviennent.
La première partie interroge la manière de prévenir les difficultés d’apprentissage des élèves, en analysant ce qui emporte parfois l’élève dans une spirale de l’échec, et quelles pratiques d’enseignement pourraient l’éviter. En posant également le problème des publics défavorisés ou difficiles. La deuxième partie se penche sur les obstacles les plus fréquents, ceux propres à l’élève, sa motivation, sa gestion des relations sociales en classes, mais aussi les obstacles contenus dans les disciplines de base : lire, écrire, compter. Quant à la troisième partie, elle aborde la question des besoins spécifiques de certaines élèves : élèves issus de familles migrantes, élèves à haut potentiel, mais aussi souffrant de handicap (autisme, surdité) ou de troubles d’apprentissage. Pour tous, il s’agit de mieux les connaître et d’envisager comment le système scolaire peut leur faire atteindre le même objectif qu’aux autres : réussir à apprendre.
L’article de Michel Fayol intitulé « L’orthographe et son apprentissage » rejoint les préoccupations de ÉROFA.
Commander dans une librairie en ligne
Qui est illettré ? Décrire et évaluer les difficultés à se servir de l’Écrit
- J.-M. Besse (dir.), Retz, 2003, 223 pages
Cet ouvrage apporte un point de vue neuf sur les personnes en situation d’illettrisme. Il questionne la réalité même de l’illettrisme, lors de situations très concrètes de communication par l’Écrit. Il montre quels sont certains des enjeux majeurs des difficultés que rencontrent ces personnes, au-delà même des questions liées à l’utilisation de l’Écrit. Il indique également à quelles conditions le chercheur ou le formateur peut aller à la rencontre de ceux-là même que notre société qualifie d’« illettrés ».
Associant travaux scientifiques et expériences « de terrain », il s’appuie notamment sur les résultats d’une étude conduite à l’aide du DMA (diagnostic des modes d’appropriation de l’Écrit) sur les parcours individuels de personnes détenues en établissements pénitentiaires, pour présenter une vision précise et documentée de leurs « manières de vivre en situation d’illettrisme » ; pour cela, lors des évaluations, la démarche adoptée s’efforce, plutôt que de noter uniquement ce qui manque chez ces personnes, de relever ce qu’elles ont réussi au cours de leurs activités, comment elles s’y sont prises, quelles sont leurs représentations de l’Écrit et d’elles-mêmes au cours de ces tâches. Ainsi devient-il possible d’envisager la mise en place de dispositifs d’aide plus adaptés à la nature des difficultés rencontrées.
Les importantes différences interindividuelles constatées interrogent de ce fait sur l’emploi d’un même terme, « illetrisme(s) », pour décrire de façon pertinente leur rapport à l’écrit ; elles questionnent également sur les limites de compétences entre les lettrés et ceux que l’on tient parfois pour illettrés : qui est « illettré » ?
S’adressant à tous ceux qui se préoccupent de la « lutte contre l’illettrisme » (acteurs de terrain, chercheurs, « décideurs »), cet ouvrage avance des propositions quant aux outils à utiliser pour l’évaluation diagnostique des publics en situation d’illettrisme et quant aux modalités de l’accompagnement des ces personnes.
Commander sur le site de l’association
Éole. Échelle d’acquisition en orthographe lexicale
- B. Pothier & P. Pothier, Retz, 2004, 256 p.
 Fruit d’un vrai travail de recherche-action de plus de six ans, validé par des enquêtes et des tests menés dans plus de 2 000 classes, Éole est une nouvelle échelle d’acquisition en orthographe lexicale destinée à l’école élémentaire. Cet outil permet aux enseignants de connaître le niveau d’acquisition des 000 mots les plus courants, à l’écrit, dans les années 2000, par classe, du CP au CM2.
Fruit d’un vrai travail de recherche-action de plus de six ans, validé par des enquêtes et des tests menés dans plus de 2 000 classes, Éole est une nouvelle échelle d’acquisition en orthographe lexicale destinée à l’école élémentaire. Cet outil permet aux enseignants de connaître le niveau d’acquisition des 000 mots les plus courants, à l’écrit, dans les années 2000, par classe, du CP au CM2.
Cette version d’Éole avec CD-ROM permet :
– d’appréhender les pourcentages de réussite orthographique des élèves pour un terme donné, du CP au CM2 ;
– d’analyser un texte entier pour évaluer le degré de difficulté en orthographe lexicale ;
– des gérer les résultats des élèves et des classes au regard des textes analysés.
Ce logiciel offre aux enseignants la possibilité d’étalonner les textes qu’ils proposent à leurs élèves favorisant ainsi un enseignement raisonné de l’orthographe lexicale.
Commander sur le site de l’éditeur
Savoir orthographier
- A. Angoujard (coord.), Hachette éducation, 1997, 134 p.
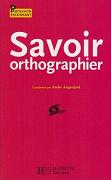 Nénuphar, nénufar… l’orthographe terrifie les uns, fascine les autres. Son enseignement met en scène un « psychodrame » permanent où maîtres et élèves évoluent entre chausse-trappes et faux-semblants.
Nénuphar, nénufar… l’orthographe terrifie les uns, fascine les autres. Son enseignement met en scène un « psychodrame » permanent où maîtres et élèves évoluent entre chausse-trappes et faux-semblants.
Véritable outil de travail conçu pour les maîtres par une équipe de chercheurs de l’INRP, cet ouvrage démontre qu’il est aujourd’hui possible de définir une autre stratégie d’enseignement et remettre l’orthographe à une place raisonnable : au service de la production d’écrits.
Commander dans une librairie en ligne
Raisonner l’orthographe au cycle III
- Jean-Pierre Sautot, SCEREN , 2002
L’orthographe est un système clos qui n’a rien de naturel. Là réside toute la difficulté de son apprentissage. Comment faire entrer les élèves dans le système orthographique ? Cet ouvrage ouvre quelques portes : construction de connaissances, raisonnements, évaluation. Inclure l’apprentissage de l’écriture dans un projet de classe ou de cycle, tel est l’objectif de ce livre. Un apport d’informations théoriques pour le maitre soutient des propositions d’activités pour les élèves. Une aide au projet répond aux inquiétudes que peut susciter le changement pédagogique sur un terrain aussi sensible que la norme orthographique.
Typologie de phrases pour l’étude de la langue ou la négociation orthographique
- Sautot J.-P. & Geoffre T. (2019). Typologie de phrases pour l’étude de la langue ou la négociation orthographique. In Scolagram.
En ligne : https://scolagram.u-cergy.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=53:typologie-de-phrases-pour-l-orthographe&Itemid=292
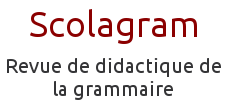 Une typologie de phrases, configurée par difficulté progressive et par niveau de classe pour apprendre l’orthographe grammaticale en raisonnant sur les structures grammaticales.
Une typologie de phrases, configurée par difficulté progressive et par niveau de classe pour apprendre l’orthographe grammaticale en raisonnant sur les structures grammaticales.
L’orthographe en crise à l’école. Et si l’histoire montrait le chemin ?
- A. Chervel, Retz, 2008, 79 p.
Orthographe recommandée. Exercices et mots courants
- C. Contant, De Champlain S. F., 2011, 216 p.
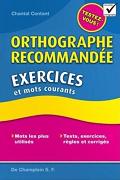 |
Testez votre orthographe. Doit-on écrire : boursoufler ou boursouffler ? extra-fort ou extrafort ? un repose-pieds ou un repose-pied ? Doutez-vous ? Venez vous familiariser avec la nouvelle orthographe recommandée. Elle est en vigueur. Répondez à plus de 750 questions. Amusant et idéal pour être à jour. 70 tests, exercices et jeux. 500 mots fréquents. Apprenez les plus récentes règles. Elles sont applicables dans toute la francophonie. En quatre étapes faciles, testez-vous et découvrez les mots touchés par les rectifications officielles de l’orthographe du français. Pour mettre à jour vos connaissances : des questions à choix multiples, des VRAI ou FAUX et des jeux de culture générale.Commander dans une librairie en ligne |
Écrire sans faute
- Michèle Lenoble-Pinson , Éditions De Boeck Duculot,2e édition, Bruxelles, 2012.
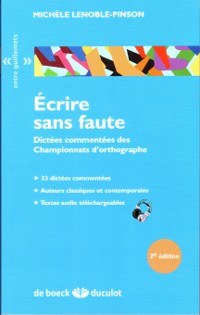 |
Cet ouvrage contient trente-trois dictées proposées lors des Championnats d’orthographe de Belgique. Michèle Lenoble-Pinson, membre du Conseil international de la langue française (Paris), était professeure aux Facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles. Elle a rassemblé ici des textes, audio téléchargeables, d’écrivains appartenant à la littérature française de Belgique. Elle présente brièvement les auteurs et, surtout, elle commente avec précision les difficultés lexicales, grammaticales et culturelles contenues dans les dictées en se fondant sur les erreurs qui ont été commises lors des Championnats.Un intérêt particulier de l’ouvrage est la présence comme variantes, non seulement des formes rectifiées en 1990 et de celles qui figurent dans les dictionnaires d’usage courant, mais aussi des formes compatibles avec le contexte et qui répondent à la logique du système orthographique français contemporain. Outil de contrôle et d’enrichissement de connaissances, cet ouvrage se prête à de fécondes réflexions linguistiques, car l’orthographe est et doit être, comme la langue elle-même, le domaine d’une évolution rationnelle. (Michèle Lenoble-Pinson a procédé en 2009 à une large révision du Français correct de Maurice Grevisse, 6e édition). Claude Gruaz. |
L’orthographe vivante, pour une évolution raisonnée
- Cycle 2/3, Claude Gruaz, Nathan
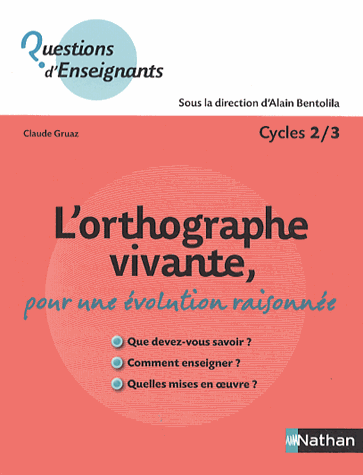 |
Comment l’orthographe s’est-elle mise en place au cours des siècles ? Si l’oral et l’écrit sont différents, leurs approches ne le sont-elles pas aussi ? Doit-on accorder une plus grande place à l’enseignement de l’orthographe ? L’usage de l’informatique ne nous oriente-t-il pas vers une nouvelle forme d’écriture ? Est-il légitime d’envisager une réforme ? Luttant contre l’idée conservatrice d’une orthographe sacrée, l’auteur nous explique, exemples à l’appui, pourquoi et comment l’écriture du français, l’une des plus difficiles au monde, devrait, progressivement, être rationalisée. |
Orthographe : à qui la faute ?
- D. Manesse, D. Cogis, M. Dorgans & C. Tallet, Postface d’A. Chervel, ESF éditeur, 2007, 250 p.
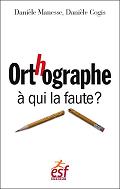 Oui ou non le niveau d’orthographe de nos enfants ou de nos élèves est-il plus mauvais aujourd’hui qu’il y a vingt ans ? Et nos arrière-grands-parents, faisaient-ils vraiment moins de fautes que nous ?
Oui ou non le niveau d’orthographe de nos enfants ou de nos élèves est-il plus mauvais aujourd’hui qu’il y a vingt ans ? Et nos arrière-grands-parents, faisaient-ils vraiment moins de fautes que nous ?
Touchant ces questions qui nous concernent tous, parents, enseignants, éducateurs en général, une étude comparative sur trois périodes différentes – 1877, 1987, 2005 – permet enfin de faire un bilan objectif sur ce sujet crucial de société.
Les lecteurs de cet ouvrage découvriront ainsi des résultats inattendus aux tests orthographiques menés. À travers eux, ils pourront trouver des éléments de réponses aux nombreux débats de société parfois très vifs sur des sujets actuels : inégalité de savoir entre garçons et filles, inégalité de savoir entre zones géographiques, rôle et place de l’écrit dans une société de l’image, etc.
Ils découvriront surtout dans cet essai passionnant, qu’au-delà des constats, des solutions existent dont, pourquoi pas, la simplification de l’orthographe ?
Commander sur le site de l’éditeur
Pour enseigner et apprendre l’orthographe : nouveaux enjeux, pratiques nouvelles
- D. Cogis, Delagrave, 2005, 428 p.
Commander sur le site de l’éditeur
Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ?
- D. Cogis, 2011, Hatier
Commander sur le site de l’éditeur
Qui a eu cette idée folle, un jour d’inventer la dictée ?
Une dictée par jour ! C’est le régime que veut imposer le ministre de l’Education nationale, aux élèves de primaire à partir de la rentrée prochaine. Jean-Michel Blanquer, l’a annoncé ce 5 décembre. La dictée n’avait bien sûr jamais disparu à l’école, mais depuis son invention au XIXe siècle, le rythme était loin d’être aussi soutenu. Bref retour sur l’histoire de cet exercice scolaire si cher à Bernard Pivot.
Écouter l’émission
Linguistique
Le système d’écriture de la langue française, ses améliorations actuelles et futures
- Desnoyers, A., « », Congrès 2012 et 2013 de l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), colloque avec comité de sélection, novembre 2012 et 2013.
Le système d’écriture du français : son évolution, son état actuel et futur
- Desnoyers, A., Les reflets du 35e congrès de l’AQEFLS, volume 34, numéro 1, 2017, pages 59 à 67.
- Desnoyers, A., Congrès 2016 de l’Association québécoise des enseignants de français langue seconde (AQEFLS), colloque avec comité de sélection, avril 2016.
- Desnoyers, A., Correspondance, revue pour l’amélioration du français en milieu collégial, Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), Montréal, volume 20, numéro 2, janvier 2015. Pour lire l’article :http://correspo.ccdmd.qc.ca/Corr20-2/5.html
Stagnation ou évolution des titres et fonctions au féminin dans le dictionnaire ?
- Farid, G. 7th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology. Las Palmas de Gran Canaria, 9-11 juillet 2014.
Homonymes en exercices
- Georges Farid, Éditions nouvelles, 2012.
Toute l’orthographe
- B. Gaillard & J.-P. Colignon
Albin Michel / Magnard, 2005, 220 p.
Accordez vos participes
- M. Sommant, Albin Michel, 2004, 154 p.
Du signe au sens. Pour une grammaire homologique des composants du mot
C. Gruaz, Presses universitaires de Rouen, 1995, 195 p.
L’orthographe française : raisons linguistiques, historiques et sociales de sa complexité ; vers des voies nouvelles
Français 2000, bulletin de l’ABPF, n°220-221 (article de C. Gruaz : « L’orthographe française : raisons linguistiques, historiques et sociales de sa complexité ; vers des voies nouvelles »)
Association Belge des Professeurs de Français, septembre 2009
Aspects du mot français
C. Gruaz, L’Harmattan, 2005, 228 p.
Vers une rationalisation de l’orthographe française
 C. Gruaz
C. Gruaz
Article paru dans Penser l’orthographe de demain, Éditions CILF, 2009, p. 75-86
Actes de la journée d’études du 17 septembre 2009 organisée par le Conseil international de la langue française
Télécharger l’article / Commander sur le site de l’éditeur
Rationaliser l’orthographe
C. Gruaz, Article paru dans Publications Alpha, n°173, 4 novembre 2011. Consulter l’article
Variations sur l’orthographe et les systèmes d’écriture. Mélanges en hommage à Nina Catach
C. Gruaz & R. Honvault (dir.), Champion, 2001, 401 p.
Autour du mot : pratiques et compétences
Séminaire du Centre du français moderne – Tome II – 2006-2009, sous la direction de C. Gruaz & C. Jacquet-Pfau
Lambert-Lucas, 2010, 240 p.
La dérivation suffixale en français contemporain
C. Gruaz, Presses universitaires de Rouen, 1995, 436 p.
Pour l’amour des mots. Glanures lexicales, dictionnairiques, grammaticales et syntaxiques.
- Hommage à Michèle Lenoble-Pinson, Textes réunis par M. Willems (article de C. Gruaz : « Vers une rationalisation des mots composés »)
Presses universitaires Saint-Louis, 2009
 |
Ce volume est offert à Michèle Lenoble-Pinson à l’occasion de son accession à l’éméritat, en hommage à sa carrière exemplaire d’enseignante et de spécialiste internationalement reconnue de la grammaire et de la lexicologie françaises. Dix-huit personnalités belges et étrangères ont glané pour elle dans les champs de la langue française des réflexions sur la norme et l’usage – notamment le Bon Usage -, sur des tournures syntaxiques récentes, sur l’analyse grammaticale traditionnelle de certains mots ; sur la maîtrise de l’orthographe, sur sa rationalisation ; sur la féminisation des titres, des noms de métiers et de fonctions ; sur la terminologie, sur l’élaboration des dictionnaires, sur l’apprentissage du vocabulaire, sur les tabous lexicaux ; sur la variation de la forme des proverbes à travers le temps et sur le vocabulaire de la chasse au vol. Ces contributions riches et variées ont été rassemblées pour l’amour des mots, en référence à l’attachement que Michèle Lenoble-Pinson a toujours porté à la discipline à laquelle elle a consacré toute sa vie professionnelle et l’ensemble de ses publications.Commander dans une librairie en ligne |
Le français correct. Guide pratique des difficultés
- M. Grevisse, 6e édition revue par M. Lenoble-Pinson, De Boeck Duculot, 2009, 351 p.
Variation lexicale et évolution graphique du français actuel
- VARLEX. (Dictionnaires récents, 1989-1997), N. Catach, avec la collaboration de J.-C. Rebejkow, Conseil International de la Langue Française, 2001, 237 p.
 La présente publication comprend le relevé de plus de 5000 variantes (mots qui s’écrivent de deux ou plusieurs façons différentes), existant actuellement entre les dictionnaires courants ou dans un seul et même ouvrage. Elle a essentiellement pour buts :
La présente publication comprend le relevé de plus de 5000 variantes (mots qui s’écrivent de deux ou plusieurs façons différentes), existant actuellement entre les dictionnaires courants ou dans un seul et même ouvrage. Elle a essentiellement pour buts :
– D’évaluer avec précision ces phénomènes mal connus ;
– De mieux cerner les évolutions prévisibles de l’usage ;
– De favoriser ainsi une harmonisation lexicale sur le moyen et le long terme et, dans la mesure du possible, la réduction progressive de cette redondance en bonne partie non utile et non contrôlée ;
– De susciter en ce domaine, surtout sur le plan graphique, la reconnaissance du principe de la variation, mais aussi celle d’une concertation permanente à ce sujet, allant dans le sens de l’évolution de la langue ; d’un soulagement relatif sur certains points pour les usagers fort gênés par cette situation ; et donc aussi, il faut l’espérer, d’une amélioration de leurs performances et une hausse de niveau dans la pédagogie.
Cette direction vers l’harmonisation avait été explicitement demandée et encouragée par l’Académie française en 1990-1991 par la bouche de son Secrétaire perpétuel, Monsieur Maurice Druon (vr Rapport sur les Rectifications de l’orthographe française, Discours de présentation du texte au Premier ministre, p.5).
Le recensement de ces variantes a constitué pour nous, en dépit de notre longue expérience un travail délicat, non seulement en raison des redoutables spécificités du secteur et des difficultés des dépouillements de ce genre sur ordinateur (toujours sujets, comme on sait, aux coquilles et erreurs, surtout lorsque les mots n’ont pas une forme simple, aisément mémorisable), mais aussi parce qu’il s’agissait de mots difficiles à trouver, ce que l’on appelle des « entrées cachées » des dictionnaires (situées en renvois, en fin d’article, sous plusieurs entrées, en sous-entrées, etc.).
Commander sur le site de l’éditeur
Publications anciennes
- Observations sur l’orthographe ou ortografie française, suivies d’une Histoire de la réforme orthographique depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours, Ambroise Firmin-Didot
A. Firmin-Didot, 1868
Consulter l’appendice A - Note sur la réforme orthographique que prépare l’Académie, X. Junius
1893
Consulter
Nouvelles Recherches en orthographe
- Sous la direction de C. Brissaud, J.-P. Jaffré et J.-C. Pellat, ED. LAMBERT LUCAS
Ces journées d’études ont permis à un ensemble de spécialistes – linguistes, psycholinguistes et didacticiens – de confronter leurs points de vue sur l’orthographe de différentes langues (japonais, turc…), et tout spécialement sur celle du français qui continue de poser de nombreux problèmes aux usagers et surtout à ceux qui l’apprennent et l’enseignent. Ces textes font un point circonstancié, et comparatiste, sur l’état des connaissances dont nous disposons aujourd’hui, qui apportent des éclairages nouveaux sur le fonctionnement, l’acquisition et la didactique de l’orthographe. Outre qu’elles remettent en question bien des idées reçues, comme celle d’un âge d’or de la pédagogie de l’orthographe, ces études contribuent à définir les conditions d’un apprentissage optimal de l’orthographe.
Parution: avril 2008
Responsable(s) scientifique(s): Catherine Brissaud, Jean-Pierre Jaffré et Jean-Christophe Pellat
Contributeurs: Mehmet-Ali Akinci, Christian Galan, Françoise Gadet, Bernard Lété, Pierre Largy, Michel Fayol, Annie Camenisch et Serge Petit, Fanny Heniqui et Martha Makassikis, Danièle Cogis, Claudie Péret, Jean-Pierre Sautot et Catherine Brissaud
Présentation (préface, introduction): C. Brissaud, J.-P. Jaffré et J.-C. Pellat
Le participe passé entre accords et désaccords
- MARSAC, F., PELLAT, J.-C., (sous la direction de), (2013) , Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 296 pages
L’accord du participe passé en français constitue un défi pour les linguistes, un enjeu pour les didacticiens, une énigme pour les élèves et un sacerdoce pour certains usagers. Depuis des siècles, il entretient en France (mais aussi en Belgique et au Canada, notamment) les débats entre les grammairiens et les pédagogues, divisés sur la question d’une réforme. Cette publication propose de faire le point sur les accords et les désaccords entre des spécialistes d’hier et d’aujourd’hui. Elle rassemble quinze articles d’auteurs de différents pays, répartis en deux ensembles complémentaires: perspectives linguistiques et perspectives didactiques.Du côté des linguistes, différents éclairages sont présentés: histoire de l’accord du participe, inventaire des règles et recherche d’explications nouvelles, comparaisons avec d’autres langues, examen de propositions de réformes, …Du côté des didacticiens, différentes observations des performances des apprenants, français et étrangers, sont analysées et des démarches didactiques renouvelées sont proposées, mettant en avant la syntaxe et/ou la sémantique.Ces articles contribuent à clarifier cette question complexe et à proposer des approches nouvelles, théoriques et pratiques. Ils s’adressent aux lecteurs français ou étrangers, étudiants ou professeurs soucieux d’un enseignement plus efficace de l’accord du participe passé. Ils visent à nourrir les réflexions de chacun, ouvertes sur l’avenir.
Première édition Presses universitaires de Strasbourg Livre broché 298 p. Index .
Les délires de l’orthographe
- N. Catach, Plon, 1989, 351 p.
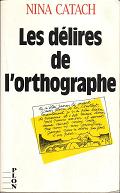 L’orthographe est devenue en France un problème national. Les Français sont tous complexés par leur orthographe. Ils en sont malades mais ce sont surtout des malades imaginaires. Nous sommes le seul pays où l’on juge (et parfois condamne) un homme sur son orthographe. Les Français sont persuadés (à tort) d’avoir la pire écriture du monde, et ils en sont fiers. Ils veulent la changer mais, mis au pied du mur, ils reculent toujours. Le meilleur moyen d’aider quelqu’un à se libérer d’un blocage, c’est encore d’en rire, et il y a de quoi. C’est ce que ce livre tente de faire.
L’orthographe est devenue en France un problème national. Les Français sont tous complexés par leur orthographe. Ils en sont malades mais ce sont surtout des malades imaginaires. Nous sommes le seul pays où l’on juge (et parfois condamne) un homme sur son orthographe. Les Français sont persuadés (à tort) d’avoir la pire écriture du monde, et ils en sont fiers. Ils veulent la changer mais, mis au pied du mur, ils reculent toujours. Le meilleur moyen d’aider quelqu’un à se libérer d’un blocage, c’est encore d’en rire, et il y a de quoi. C’est ce que ce livre tente de faire.
Écrit par l’une des plus grandes spécialistes de la langue française, ce dictionnaire, volontiers provocateur et souvent drolatique, raconte l’histoire de notre langue et de ses nécessaires transformations. Il apporte des réponses inattendues à l’épineuse question du maintien de l’orthographe et propose des réformes à adopter d’urgence si nous ne voulons pas que notre langue appartienne à des grammairiens malades de la langue.
Commander dans une librairie en ligne
L’orthographe
- N. Catach, Presses universitaires de France, collection Que sais-je ? (n° 685), 1978 (9e édition 2004), 128 p.
 Toute écriture connaît certaines règles ou conventions qui en contrôlent l’usage. Dans le cas du français, nous sommes souvent loin d’une transcription simple de la langue parlée, d’une correspondance parfaite entre le son et le signe. Les auteurs de la Grammaire générale le soulignaient déjà : « Il y a certaines lettres qui ne se prononcent point, et qui ainsi sont inutiles quant au son, lesquelles ne laissent pas de nous servir pour l’intelligence de ce que les mots signifient… ». L’écriture peut sembler conçue pour les seuls lettrés et spécialistes…
Toute écriture connaît certaines règles ou conventions qui en contrôlent l’usage. Dans le cas du français, nous sommes souvent loin d’une transcription simple de la langue parlée, d’une correspondance parfaite entre le son et le signe. Les auteurs de la Grammaire générale le soulignaient déjà : « Il y a certaines lettres qui ne se prononcent point, et qui ainsi sont inutiles quant au son, lesquelles ne laissent pas de nous servir pour l’intelligence de ce que les mots signifient… ». L’écriture peut sembler conçue pour les seuls lettrés et spécialistes…
Avec une grande clarté, cet ouvrage retrace l’histoire de l’orthographe, analyse les réformes entreprises, et se penche sur les méthodes pédagogiques à mettre en œuvre afin de faciliter son apprentissage.
Commander dans une librairie en ligne
Dictionnaire historique de l’orthographe française
- sous la direction de N. Catach, Larousse, 1995, 1327 p.
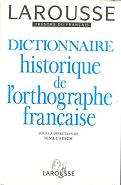 Quand nos mots ont-ils pris la forme familière qu’on leur connaît aujourd’hui ? Sont-ils ainsi depuis l’origine, et quelle origine ? Comment est-on passé de « clincaillier » à « quincaillier », d’« oriflambe » à « oriflamme », de « regnard » à « renard » ? Pourquoi « otage », de la même famille que « hôte » et « hôpital », ne prend-il pas de « h » ?
Quand nos mots ont-ils pris la forme familière qu’on leur connaît aujourd’hui ? Sont-ils ainsi depuis l’origine, et quelle origine ? Comment est-on passé de « clincaillier » à « quincaillier », d’« oriflambe » à « oriflamme », de « regnard » à « renard » ? Pourquoi « otage », de la même famille que « hôte » et « hôpital », ne prend-il pas de « h » ?
Un mot est toujours unique, et le lecteur trouvera dans ce nouvel ouvrage le roman personnel de chacun d’eux : le détail de son évolution graphique et phonétique depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours, les changements ou même les surprenantes métamorphoses qu’il a subis, les erreurs d’étymologie, les anecdotes, les disputes, les remarques pittoresques faites à son sujet…
Le lecteur découvrira également le travail séculaire et les hésitations de l’Académie française, car c’est dans les éditions successives du dictionnaire de cette institution, ainsi que dans d’autres vénérables dictionnaires, que les mots de l’ouvrage ont été attestés et étudiés.
Résultat de trente années de recherches, ce livre présente une mine de connaissances. Véritable évènement dans le domaine de l’histoire de la langue, il deviendra vite non seulement un ouvrage de référence mais aussi une source de plaisir pour tous ceux qui lisent et travaillent sur la langue et les textes anciens, pour les enseignants, les formateurs et pour tous les curieux de l’histoire des mots.
Commander dans une librairie en ligne
L’orthographe française à l’époque de la Renaissance
- N. Catach, Droz, 1968, 496 p.
 Cet ouvrage est la thèse de Nina Catach, soutenue en 1968, œuvre unique par son contenu, qui a conféré à l’auteure le statut incontesté de meilleure spécialiste française de l’histoire de l’orthographe française.
Cet ouvrage est la thèse de Nina Catach, soutenue en 1968, œuvre unique par son contenu, qui a conféré à l’auteure le statut incontesté de meilleure spécialiste française de l’histoire de l’orthographe française.
Il est le fruit d’une enquête, non en surface, chez quelques grammairiens et lexicographes, mais en profondeur, afin de comprendre ce qui semblait à priori incompréhensible, de quelle pratique quotidienne, de quels efforts cachés, de quelles contradictions internes du XVIe siècle, étaient issus les changements orthographiques ultérieurs. Voilà ce que l’auteure a tenté de faire, sans prétendre pour cela apporter autre chose qu’un éclairage nouveau, mais non exhaustif, sur la question orthographique.
Théories orthographiques et faits typographiques ne sont intéressants que par leurs rapports mutuels, rapports assez importants à l’époque-charnière que constitue la Renaissance pour constituer la voie transitionnelle entre le système orthographique du moyen-français (système manuscrit) et le système orthographique du français moderne (système imprimé).
Commander dans une librairie en ligne
Le participe passé autrement
mmander sur le site de l’édite
Miscellanées I
- Jean-Pierre Jaffré, Editions de Sade
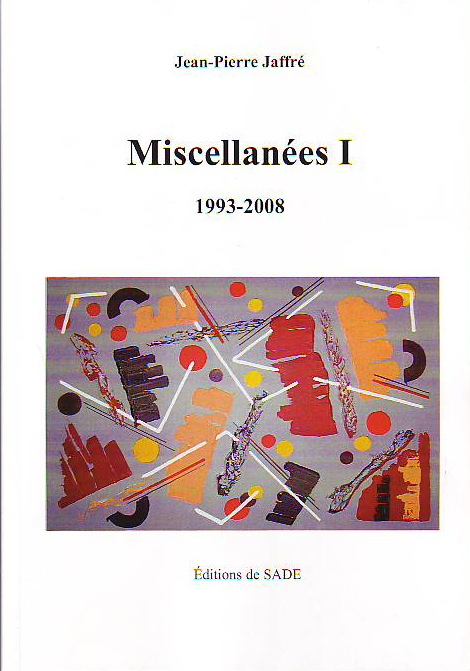 Association de textes divers rassemblant des observations de recherche. Le texte décrit le cheminement d’une linguistique en train de se faire, sur le versant des écritures, des orthographes et de leur apprentissage.
Association de textes divers rassemblant des observations de recherche. Le texte décrit le cheminement d’une linguistique en train de se faire, sur le versant des écritures, des orthographes et de leur apprentissage.
Petite Histoire de l’orthographe Française
- Wilmet M., Académie Royale de Belgique
Dans l’histoire du langage, l’écriture arrive en second et se règle donc sur la prononciation. Pour qu’elle soit dite « phonétique », il suffit qu’à chaque phonème corresponde un seul et même graphème. L’idéal… Quasi réalisé en latin, approché en italien et en espagnol, mais largement inaccessible en français. Pourquoi ?
La cause essentielle tient à l’accroissement du nombre de phonèmes sans augmentation concomitante du nombre de graphèmes. S’ajoutent, au Moyen Âge, le souci ornemental d’étoffer les mots trop courts et, à la Renaissance, des préoccupations étymologiques d’érudits (parfois mal informés).
C’est aussi au XVIe siècle qu’apparaissent les premières velléités de réformes. Les volumes successifs du Dictionnaire de l’Académie auront beau adopter quelques propositions simplificatrices, elles se raréfient d’une édition à l’autre, surtout à partir de l’enseignement obligatoire, dont l’orthographe devient le fer de lance. La dernière tentative en date remonte à 1990. Ses allures de croisade valent qu’on s’y attarde.
Marc Wilmet est professeur émérite à l’Université libre de Bruxelles et membre de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises. Professeur invité de nombreuses universités étrangères, il fut aussi président de la Société internationale de linguistique romane.
Variations sur l’orthographe et les systèmes d’écriture
- C. Gruaz & R. Honvault (dir.), Champion, 2001, 401 p.
Nina Catach, Directrice de Recherche au CNRS, dirigea, jusqu’en 1986, l’équipe HESO qu’elle avait créée en 1970. Elle fut la grande spécialiste de l’histoire de l’orthographe française, internationalement reconnue. Elle publia de nombreux ouvrages et articles sur l’orthographe, au premier rang desquels figure le magistral Dictionnaire historique de l’orthographe française. Ses collègues et amis ont voulu, à travers ces Hommages, montrer l’étendue de son champ de recherches : le système graphique du français et son traitement informatique, l’évolution historique de l’orthographe et les variantes dialectales, les autres systèmes d’écriture et les réformes de l’orthographe. Elle obtint, entre autres dictinctions, le Grand Prix de l’Académie française en 1995.
Commander dans une librairie en ligne
Toute l’orthographe
- B. Gaillard & J.-P. Colignon, Albin Michel / Magnard, 2005, 220 p.
 Comment forme-t-on le féminin des noms et des adjectifs ? Où faut-il mettre un trait d’union ? Quelles sont les règles d’accord du participe passé ? Ces questions, et bien d’autres, trouvent immédiatement leur réponse dans Toute l’orthographe grâce à une présentation claire et accessible, une méthodologie simple, des astuces pour comprendre et retenir les bonnes règles, des exemples vivants pour les illustrer. Aussi utile en classe qu’au bureau ou à la maison, Toute l’orthographe a été conçu pour que le lecteur, quel que soit son âge, maîtrise la langue française sur le bout des doigts !
Comment forme-t-on le féminin des noms et des adjectifs ? Où faut-il mettre un trait d’union ? Quelles sont les règles d’accord du participe passé ? Ces questions, et bien d’autres, trouvent immédiatement leur réponse dans Toute l’orthographe grâce à une présentation claire et accessible, une méthodologie simple, des astuces pour comprendre et retenir les bonnes règles, des exemples vivants pour les illustrer. Aussi utile en classe qu’au bureau ou à la maison, Toute l’orthographe a été conçu pour que le lecteur, quel que soit son âge, maîtrise la langue française sur le bout des doigts !
Commander dans une librairie en ligne
Mieux comprendre le participe passé
Mieux comprendre le participe passé, G. Farid, Éditions nouvelles, 2006, 158 p.
Plus de 800 exercices et leur corrigé explicatif contribueront à approfondir et à consolider les différentes règles du participe passé.
La dernière section met en lumière les cas où des grammairiens de notoriété permettent le choix quant à la variabilité ou la non-variabilité dans l’accord du participe passé.
Mieux comprendre le participe passé est un livre pratique destiné aux niveaux collégial et universitaire, et à toute personne soucieuse de la qualité du français écrit.
Commander dans une librairie en ligne
La variation graphique : champs, facteurs
- in Études de linguistique appliqué, n°159, coordonné par C. Martinez (articles de C. Martinez : « Exploration des facteurs de variation de l’écrit » et de C. Gruaz : « Lexique et variation sérielle »), Klincksieck, juillet-septembre 2010, 128 p.
La variation graphique touche régulièrement certains types d’écrits : dialogues en ligne, SMS, prise de notes, publicité, etc. Elle se manifeste souvent dans la production de certains scripteurs : apprenants, auteurs régionaux, etc. De plus, elle touche régulièrement des zones précises du système graphique : pour le français, traits d’union, signes diacritiques, néologismes, irrégularités du système, etc. Il s’agira de circonscrire cette variation graphique, à travers l’étude de divers cas de figure.
Avec des contributions de C. Gruaz, J.-P. Jaffré, F. Jejcic, C. Martinez, J. Pruvost, A. Tatossian, G. Terrien.
La grammaire invisible
 Périard Mario, 2017, La grammaire invisible, Editions Séditieuses
Périard Mario, 2017, La grammaire invisible, Editions Séditieuses
On nous a beaucoup parlé de la grammaire, celle de la « langue » scolaire, mais jamais de la gram-mère, celle de la langue apprise sur les genoux de notre mère. Ce petit essai-grammaire illustre avec éloquence ce que la norme orthographique nous empêche de voir: Le genre féminin est la forme de référence autour de laquelle se structure notre langue.
On la devine un peu pourtant, cette grammaire invisible et qui s’entend, cette grammaire qu’un francophone de naissance maîtrise assez bien, sans trop le savoir, en obéissant inconsciemment à ses injonctions tacites.
Dans sa grammaire buissonnière et insolente, Mario Périard nous dévoile les dessous étonnamment féminins de notre langue (parlée)… une description du français telle que des extra-terrestres aveugles pourraient la concevoir!
Qui veut la peau du français ?
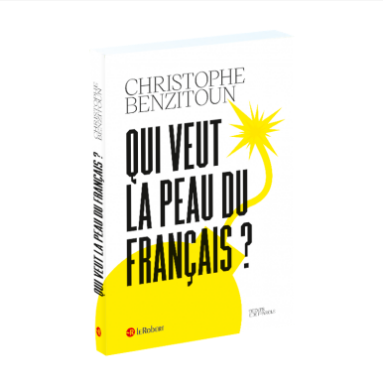 Notre niveau en orthographe baisse depuis trente ans. Sont mis en cause Internet et les nouvelles technologies, la méthode globale, les ministres de l’Éducation nationale et leurs réformes, les programmes scolaires, voire la baisse de l’intelligence des enfants eux-mêmes…Mais désigne-t-on les bons coupables ? Que s’est-il donc passé pour qu’on en arrive à un constat si accablant ?
Notre niveau en orthographe baisse depuis trente ans. Sont mis en cause Internet et les nouvelles technologies, la méthode globale, les ministres de l’Éducation nationale et leurs réformes, les programmes scolaires, voire la baisse de l’intelligence des enfants eux-mêmes…Mais désigne-t-on les bons coupables ? Que s’est-il donc passé pour qu’on en arrive à un constat si accablant ?
Notre niveau en orthographe baisse depuis trente ans. Sont mis en cause Internet et les nouvelles technologies, la méthode globale, les ministres de l’Éducation nationale et leurs réformes, les programmes scolaires, voire la baisse de l’intelligence des enfants eux-mêmes…
Mais désigne-t-on les bons coupables ? Que s’est-il donc passé pour qu’on en arrive à un constat si accablant ? Pour Christophe Benzitoun, le problème vient des défenseurs du bon usage qui ont fait subir depuis des siècles des complications insensées à l’orthographe et à la grammaire, devenues intouchables, sacrées. Au point de créer une fracture irrémédiable entre la langue écrite et la langue orale qui, elle, ne cesse de se transformer. À vouloir protéger le français contre un péril mortel imaginaire, on risque de le figer, de le fossiliser, d’en faire une langue morte comme le latin et le grec ancien. Dans cet essai documenté et passionnant, l’auteur défend la nécessité d’une vraie modernisation du français. Modernisation indispensable pour que le français reste une langue vivante ! Christophe Benzitoun est enseignant-chercheur en linguistique française à l’université de Lorraine et membre du laboratoire ATILF.
L’intégralité des droits d’auteur de ce livre sera reversée à l’Association de formation et de recherche sur le langage qui prévient l’échec scolaire et lutte contre l’illettrisme en France.
Réformes & rectifications
L’orthographe en quatre temps
 L’ORTHOGRAPHE EN QUATRE TEMPS
L’ORTHOGRAPHE EN QUATRE TEMPS
20E ANNIVERSAIRE DES RECTIFICATIONS DE L’ORTHOGRAPHE DE 1990 :
Enseignement, recherche et réforme, quelles convergences ?
Actes du Colloque international de 2010 sous la direction de Susan Baddeley, Fabrice Jejcic et Camille Martinez
Le 6 décembre 1990 paraissait, dans la section Documents administratifs du Journal officiel, le rapport du Conseil supérieur de la langue française intitulé « Les Rectifications de l’orthographe ». Ce rapport, le fruit d’un long travail de concertation entre linguistes, lexicographes, personnalités politiques et médiatiques, proposait non pas une réforme de l’orthographe française mais des « Rectifications » destinées à éliminer quelques-unes des anomalies les plus flagrantes de l’écrit du français, et se voulait un premier pas vers sa modernisation.
Vingt ans après, un colloque organisé à l’initiative de deux membres de l’ancienne équipe CNRS-HESO (qui, autour de sa fondatrice et directrice, Nina Catach, avait été au premier plan de cette initiative) se proposait non seulement de faire le bilan de cette « mini-réforme », vingt ans après, mais aussi de se pencher sur la question plus large de la place de l’écrit dans la société. Le colloque a réuni de nombreux spécialistes de l’orthographe, venus de tous le s pays francophones et d’ailleurs, pour faire le point sur l’état actuel des recherches et les perspectives futures.
Ce volume d’actes en regroupe les principales communications, et s’organise autour des quatre grands thèmes du colloque : histoire et société, enquêtes et corpus, enseignement et didactique, futures réformes.
Cet ouvrage contient les communications des membres de EROFA suivantes :
– Pierre Encrevé : Dans les coulisses des Rectifications.
– S. Baddeley : L’orthographe avant l’Académie : les tentatives de réforme et leur accueil.
– Marinette Matthey : L’accord du participe langue première ou seconde : quelques données de terrain.
– Catherine Brissaud, Danièle Cogis, Claudie Péret : L’enseignement du français : une mission encore possible ?
– Elena Llamas Pombo : Prestige normatif et diffusion des réformes orthographiques : les cas du français et de l’espagnol en contraste.
– Georges Legros : Rationaliser l’orthographe grammaticale ? L’exemple des participes.
– Claude Gruaz : Dans le sillage des Rectifications de 1990 : les recherches de EROFA.
Commander sur le site de l’éditeur
L’orthographe en débat
- N. Catach, Nathan université, 1991, 304 p.
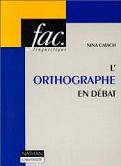 Y a-t-il une « crise » de l’orthographe ? Pourquoi changer ? Pourquoi ne pas changer ? Par où commencer, et comment faire ? L’orthographe en débat fait le point sur les arguments avancés de part et d’autre et sur tous les aspects historiques, techniques, scientifiques et sociaux des problèmes posés par un changement de l’orthographe dans la France d’aujourd’hui.
Y a-t-il une « crise » de l’orthographe ? Pourquoi changer ? Pourquoi ne pas changer ? Par où commencer, et comment faire ? L’orthographe en débat fait le point sur les arguments avancés de part et d’autre et sur tous les aspects historiques, techniques, scientifiques et sociaux des problèmes posés par un changement de l’orthographe dans la France d’aujourd’hui.
Après une solide introduction générale, sont abordés les différents dossiers concernant les points étudiés par les experts, puis viennent les Listes complètes des mots modifiés, établies sous la direction de l’auteur (Lexique orthographique, 2 000 mots, dont environ 500 ont des variantes nouvelles déjà admises). L’ouvrage deviendra vite indispensable à tous
Commander dans une librairie en ligne
Réformer l’orthographe ?
Réimpression fac-similé de PUF, 1993.
Ce sont des remerciements émus que j’adresse à Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Car c’est elle qui m’a donné l’idée de rééditer Réformer l’orthographe ? précédemment paru aux PUF en 1993. C’est son article « Oui aux dictées quotidiennes à l’École ! », publié dans Le Monde le 19 septembre 2015, qui m’a décidé. Il est au plus haut point intéressant, cet article, tant par ce qu’il dit que par ce qu’il tait. Il prend position avec vigueur en faveur de la dictée. La dictée, certes, contribue, comme le dit la Ministre, à l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et même du maniement du langage oral. Cependant, chacun le sait, la dictée est aussi, j’allais dire surtout, un des moyens d’apprentissage de l’orthographe. Pas le seul, certes, mais peut-être le principal, en tout cas le plus facile à mettre en œuvre. On s’étonne donc du silence qui efface totalement, dans cet article sur la dictée, cette composante de la langue qu’est l’orthographe, à commencer par son nom. Conséquence nécessaire : les moyens de son apprentissage – par exemple « la description du système linguistique », c’est-à-dire la grammaire – sont explicitement rejetés. Ainsi passée sous silence, l’orthographe ne donne évidemment lieu à aucune remarque sur ce qui la caractérise en langue française : la complexité, d’ou la difficulté de son apprentissage et, par suite, la possibilité –, certains parlent de la nécessité –, de sa réforme. Problème récurrent, depuis bien longtemps. Mon ouvrage essaie, modestement, d’en préciser les termes.
L’orthographe nouvelle est arrivée
- Français 2000, bulletin de l’ABPF, n°220-221,Association Belge des Professeurs de Français, septembre 2009
Commander sur le site de l’association
Penser l’orthographe de demain
- Éditions CILF, 2009, p. 75-86, Actes de la journée d’études du 17 septembre 2009 organisée par le Conseil international de la langue française
 |
Commander sur le site de l’éditeur
Les rectifications de l’orthographe du français. La nouvelle orthographe accessible
- C. Contant & R. Muller, De Boeck Duculot, coll. Entre guillemets, 2010, 63 p.
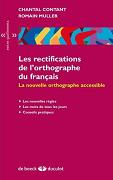 |
Les rectifications de l’orthographe du français répond aux besoins de ceux qui veulent avoir un aperçu complet mais simplifié de la nouvelle orthographe : il explique chaque règle en s’appuyant sur de nombreux exemples de mots fréquents et donne des astuces pour écrire en nouvelle orthographe quotidiennement, au bureau ou à l’école. Un livre accessible à tout le monde, en langage simple et clair. Idéal pour les rédacteurs, journalistes, secrétaires, enseignants, parents, élèves et tous ceux qui ne sont pas des spécialistes de la langue…Commander dans une librairie en ligne |
Le millepatte sur un nénufar. Vadémécum de l’orthographe recommandée
- RENOUVO, 2005, 38 p.
Les Rectifications de l’orthographe, approuvées par l’Académie française et publiées au Journal officiel le 6 décembre 1990, portent sur environ deux-mille mots. On en trouvera la liste alphabétique dans ce fascicule, précédée par une présentation abrégée des principales rectifications.
Commander auprès de la Librairie du Québec
Orthographe : qui a peur de la réforme ?
- G. Legros et M.-L. Moreau, Orthographe : qui a peur de la réforme ?, Bruxelles, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service de la langue française, 2012.
Des exemplaires papier peuvent être obtenus pour la somme de 3 euros ; les commandes peuvent être adressées à langue.francaise@cfwb.be. Un exemplaire est mis en accès libre sur le site www.languefrancaise.cfwb.be.
Le petit livre d’or
Le langage n’est ni figé, ni neutre. L’orthographe du français a évolué de tout temps, elle continue de changer. Le langage reflète nos valeurs, nos mœurs, notre organisation sociale en perpétuelle mutation. De manière convergente avec d’autres pays francophones, la Conférence intercantonale de l’instruction publique (Suisse) estime à son tour que c’est le moment d’ancrer dans l’enseignement de la langue française à l’école en Suisse romande certains usages désormais bien reconnus, dans les dictionnaires notamment. La production d’une nouvelle collection romande de moyens d’enseignement du français lui en donne l’occasion. Ce petit livre d’OR présente brièvement les 14 principes de l’orthographe rectifiée. Il contient aussi une règle pour sensibiliser les élèves à une écriture qui s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Comité de pilotage : Nicolas Bindschedler, Pascale Marro, François Modoux
Textes : CIIP
Ortografe : qui a peur de la réforme ?
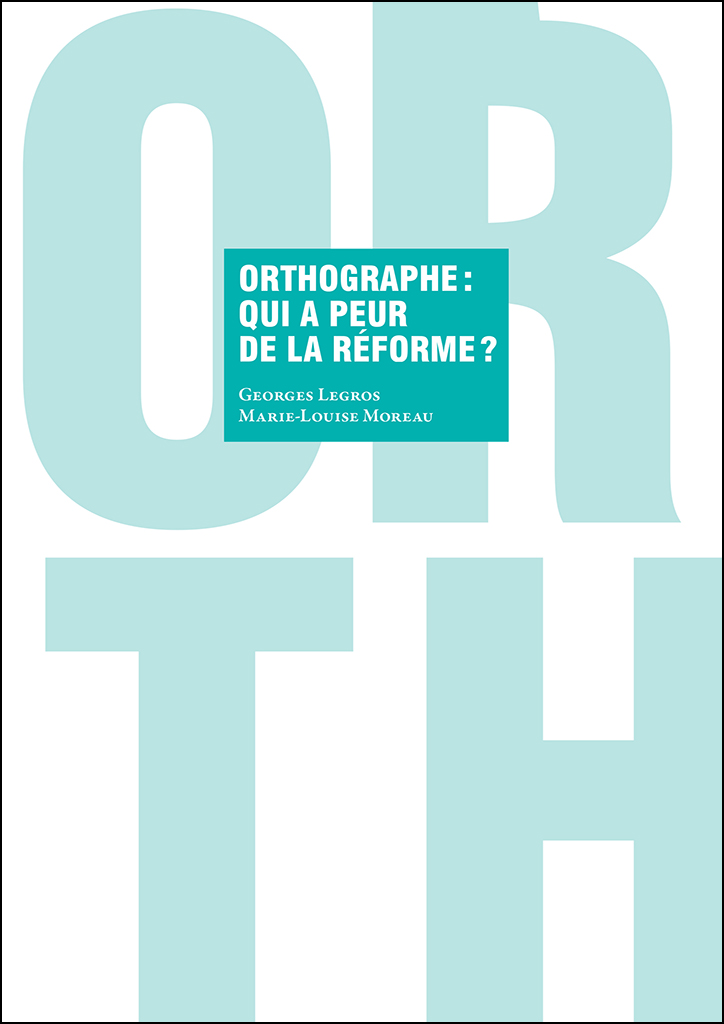 Le livre numérique gratuit Ortografe : qui a peur de la réforme ?
Le livre numérique gratuit Ortografe : qui a peur de la réforme ?
(de Marie-Louise Moreau et Georges Legros) explique un tas de choses
sur l’ortografe : pourquoi l’ortografe est come èle est, coment èle a
évolué dans le passé, les idées fausses qu’on s’en fait, les craintes
que génèrent une réforme, etc.
« Orthographe mon amour », « L’orthographe, une passion française », « Les timbrés de l’orthographe »… Ainsi s’intitulent deux livres1 et un nouveau magazine. Ces formules indiquent d’emblée qu’à propos de notre orthographe – de ses particularités internes (règles et exceptions, justifications, difficultés…), de son importance sur le plan socioprofessionnel, de son enseignement et des résultats de celui-ci, ou, a fortiori, d’éventuels projets de réforme –, les débats risquent de réserver une large part à l’irrationnel. Toutes les enquêtes scientifiques aboutissent d’ailleurs à ce même constat. Aborde-t-on les questions touchant à l’orthographe française de manière plus rationnelle et sereine, quand on dispose d’informations plus rigoureuses ? C’est bien parce que nous le pensons que nous avons conçu la présente brochure.
Dans notre société, la maitrise de l’orthographe, bien que (ou parce que ?) largement lacunaire chez beaucoup, est encore souvent conçue comme un impératif auquel doivent se soumettre les individus qui ambitionnent d’occuper une bonne position sociale. La presse ou divers sites et forums d’Internet le rappellent fréquemment, une orthographe correcte est un atout précieux dans un curriculum vitae : certains directeurs de ressources humaines ne trient-ils pas les dossiers de candidature d’abord sur le critère de leur orthographe, sans même examiner les qualités en rapport avec l’emploi postulé ? Plus généralement, bien des personnes qui ont intégré les normes orthographiques ressentent quelque fierté à disposer de ce capital symbolique, et elles épinglent volontiers les écarts qu’elles repèrent dans la production d’autrui, y trouvant matière à doléance, dérision ou stigmatisation. Peu d’entre elles sont prêtes à considérer l’orthographe avec une certaine relativité. Elle est posée comme un absolu : on ne peut y déroger en aucun cas et la modifier reviendrait à y introduire des « fautes ».
Pourtant, depuis ses origines, la manière dont il fallait écrire le français a suscité nombre d’interrogations, d’analyses et de multiples propositions d’aménagement. En 1868, Ambroise Firmin Didot recense près de 150 travaux sur la question, publiés entre 1527 et la sortie de son propre ouvrage. Et le mouvement ne s’est pas ralenti depuis, bien loin de là. Même la généralisation progressive de la scolarisation primaire n’y a pas suffi : l’échec de l’école à faire acquérir les normes orthographiques par tous a suscité, de 1880 à 1990, une telle suite de critiques et de projets de réforme qu’on a pu parler d’« Un siècle de débats et de querelles » (Keller 1999).
De toute évidence, depuis bien longtemps, l’orthographe française est ressentie par beaucoup d’esprits, souvent des plus compétents en la matière, comme une source d’insatisfaction ; mais leurs propositions pour y porter remède, aussi argumentées soient-elles, soulèvent en général des oppositions si vives qu’elles ne peuvent aboutir. Des passions comparables se retrouvent d’ailleurs dans d’autres communautés linguistiques, quand les autorités décident d’instaurer ou de modifier une norme orthographique. Ainsi, l’établissement d’un système d’écriture commun pour le créole d’Haïti, ou pour celui de la Réunion ou de la Martinique, a été et est encore l’objet de multiples controverses ; l’Acordo ortográfico da lingua portuguesa de 1990, qui vise à créer une orthographe identique pour tous les pays lusophones, n’a pu être conclu qu’après un bon demi-siècle de discussions entre le Portugal et le Brésil, et il n’est pas encore ratifié par tous les partenaires (Monteiro 2009) ; et, plus près de nous, il faut se rappeler à quels interminables débats ont donné lieu les réformes des orthographes allemande (Ball 1999) ou néerlandaise2 de 1998.
Qu’est-ce qui motive tant de passion ? Si on n’y voyait que l’expression d’une simple résistance au changement, on aurait du mal à comprendre pourquoi tant de discussions animées entourent l’élaboration des orthographes créoles, qui ne se heurte pourtant pas à l’obstacle d’un système préalablement généralisé. Ou bien pourquoi, au contraire, bien peu d’entre nous s’émeuvent quand on modernise le graphisme des signaux routiers ou l’allure générale des pictogrammes qui indiquent dans les lieux publics où se trouvent l’escalier, l’ascenseur, la sortie, les toilettes, etc. Pourtant, il s’agit bien de codes partagés, ici aussi.
C’est que la langue et son orthographe – souvent indument confondues, nous le verrons – sont toutes deux chargées symboliquement. Il s’agit de produits à la fois sociaux et individuels, qui activent de profonds sentiments de propriété et d’identité. On « s’approprie » une langue ; par sa pratique, on est relié à une communauté, dont on partage les échanges informatifs ou émotionnels, les récits quotidiens ou les mythologies, les analyses spontanées ou savantes du monde ; on lui appartient, à l’exclusion de toutes les autres, dont on ne comprend pas les discours : les Grecs de l’Antiquité appelaient barbares tous ceux qui ne parlaient pas leur langue, et l’on sait, aujourd’hui encore, à quelles difficultés peut se heurter la vie en commun dans les pays plurilingues. Cette propriété, cette identité, personnelle et sociale, certains les pensent menacées si on modifie les normes orthographiques. Mais ces sentiments, comme la menace supposée, ne s’alimentent-ils pas essentiellement à l’imaginaire linguistique ? Prennent-ils en compte toutes les dimensions objectives de la langue, de l’orthographe et de ses réformes plausibles ?
C’est précisément pour offrir aux lecteurs une information objective que cette brochure a été conçue. Ses auteurs n’entendent pas apporter sur l’orthographe un savoir neuf. Ils n’ont pour autre ambition que de mettre à la disposition du public, de manière succincte, une synthèse des acquis scientifiques consensuels les plus importants sur le sujet, sans entrer dans les détails techniques, disponibles dans de très nombreux ouvrages plus spécialisés, dont la bibliographie fournit les références.
Dans un premier temps, nous répondrons aux questions « Qu’est-ce qu’une orthographe ? », « Quelles sont les caractéristiques de l’orthographe française ? », « À quelles conséquences conduisent ses difficultés ? » (point 1). Nous exposerons ensuite les remèdes pédagogiques proposés pour améliorer les compétences orthographiques des élèves (point 2) et poursuivrons sur les principales réformes orthographiques envisagées par les spécialistes (point 3). Nous essaierons de voir ensuite, avant de conclure, sur quoi reposent les positions des personnes hostiles à une réforme (point 4).
Les quelques termes savants qui pourraient faire difficulté au lecteur non linguiste seront brièvement définis dans un petit glossaire final.
Sociologie et sociolinguistique
Les rectifications orthographiques de 1990 : analyse des pratiques réelles (Belgique, France, Québec, Suisse, 2002-2004)
- L. Biedermann-Pasques & F. Jejcic (éds).Délégation générale à la langue française et aux langues de France / Presses universitaires d’Orléans, 2006, 154 p.
Ce volume correspond à deux préoccupations qu’avait formulées l’Académie française en approuvant les recommandations du Conseil supérieur de la langue française, publiées en décembre 1990 par le Journal officiel : d’une part, que les recommandations devaient être soumises à l’épreuve du temps et, d’autre part, que la francophonie constituait désormais un sujet toujours présent à son esprit (cf. Avertissement du premier tome de son Dictionnaire, 1992, 9e édition en cours). Ainsi, il nous a paru opportun de mener une enquête sur les pratiques orthographiques réelles des francophones d’aujourd’hui. De l’ensemble des analyses et des contributions, on retiendra surtout : que les rectifications ont été largement adoptées dans les dictionaires et que la connaissance de celles-ci varie d’un pays à l’autre. D’autre part, le fait que les étudiants pratiquent un nombre non négligeable de rectifications en toute ignorance indique que celles-ci rencontrent la logique de la langue. Bref, un bilan contrasté mais positif qui, après une quinzaine d’années, rend légitime ces « nouvelles variantes libres » ; reste encore à les mettre à la portée de tous.
L’orthographe, une norme sociale
- B. Wynants, Mardaga, 1997, 284 p.
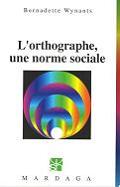 La transformation des normes de l’écriture est au cœur des mutations politiques et culturelles contemporaines et elle peut nous en donner une clé de compréhension. L’orthographe n’est pas un code purement technique ; c’est une norme sociale, cristallisation d’échanges sociaux complexes. Comment a-t-elle été construite, comment lui a-t-on donné sens et comment se transforme-t-elle ? Fixée au XIXe siècle, l’orthographe française est prise aujourd’hui dans un réseau de pratiques et de discours contradictoires : le code lui-même est resté stable (à quelques exceptions près) mais les usages, et surtout les significations qui lui sont accordées ont profondément changé.
La transformation des normes de l’écriture est au cœur des mutations politiques et culturelles contemporaines et elle peut nous en donner une clé de compréhension. L’orthographe n’est pas un code purement technique ; c’est une norme sociale, cristallisation d’échanges sociaux complexes. Comment a-t-elle été construite, comment lui a-t-on donné sens et comment se transforme-t-elle ? Fixée au XIXe siècle, l’orthographe française est prise aujourd’hui dans un réseau de pratiques et de discours contradictoires : le code lui-même est resté stable (à quelques exceptions près) mais les usages, et surtout les significations qui lui sont accordées ont profondément changé.
La transformation du rapport à l’orthographe est particulièrement sensible sur deux terrains : l’école et l’espace public français, notamment à l’occasion de la « guerre du nénufar », qui a fait rage au cours de l’hiver 90-91. À l’école, l’orthographe est prise dans les contradictions entre différentes logiques d’activités : la sélection scolaire, la hiérarchie des savoirs et les principes pédagogiques. Et elle apparaît, dans le débat public sur la réforme, profondément déchirée entre deux définitions de la dynamique sociale qui étaient encore étroitement articulées au XIXe siècle : l’intégration et la cohésion sociales. Le paradoxe de l’orthographe tient à ce que le code résiste jusqu’à présent à ce double éclatement, celui des principes de l’activité dans le cadre scolaire et celui des définitions de la société.
Commander dans une librairie en ligne
L’orthographe de tous les jours. Enquête sur les pratiques orthographiques des Français
- Vincent Lucci & Agnès Millet, Honoré Champion, 1994
 Les recherches sociolinguistiques sur les réalités orales de l’utilisation de la langue ont montré depuis longtemps que la variation était inhérente à la pratique langagière. Or, il est une norme qu’on imagine volontiers ne devoir subir aucune distorsion, c’est la norme orthographique. L’idéal normatif jette un voile pudique sur les pratiques, rejetées, lorsqu’elles sont déviantes, dans les désordres de la faute. L’orthographe de tous les jours livre, dans une démarche descriptive qui s’interdit tout jugement de valeur, les résultats d’une vaste enquête sur cette variation orthographique. Cette étude constitue une photographie objective de l’orthographe dans ses usages réels. Les observations tentent d’embrasser la diversité des situations d’écriture et des scripteurs : journaux et écrits manuscrits (lettres de demande d’emploi, correspondances privées, cahiers de liaison) de scripteurs ordinaires ou de futurs professionnels (futurs professeurs, futurs secrétaires) sont analysés à travers une grille précise d’évaluation, dont la reproductibilité permet d’éviter tout discours impressionniste sur la baisse du niveau orthographique en milieu non-scolaire. Les enseignants, qui jouent un grand rôle dans l’évaluation de la » faute » et dans la transmission de la norme n’ont pas été oubliés. L’ouvrage présente les résultats d’une enquête qui vise à rendre compte de leurs jugements sur les erreurs ainsi que de leurs, connaissances et de leur mise en pratique des rectifications proposées par le Conseil Supérieur de la Langue Française. Ainsi, les décideurs en matière orthographique, les instances qui régulent notre orthographe, comme tous ceux qui sont concernés par son devenir auront à disposition un ouvrage de référence, témoin à travers des milliers de lettres, de prises de notes, d’écrits individuels variés, de l’écriture réelle de notre époque.
Les recherches sociolinguistiques sur les réalités orales de l’utilisation de la langue ont montré depuis longtemps que la variation était inhérente à la pratique langagière. Or, il est une norme qu’on imagine volontiers ne devoir subir aucune distorsion, c’est la norme orthographique. L’idéal normatif jette un voile pudique sur les pratiques, rejetées, lorsqu’elles sont déviantes, dans les désordres de la faute. L’orthographe de tous les jours livre, dans une démarche descriptive qui s’interdit tout jugement de valeur, les résultats d’une vaste enquête sur cette variation orthographique. Cette étude constitue une photographie objective de l’orthographe dans ses usages réels. Les observations tentent d’embrasser la diversité des situations d’écriture et des scripteurs : journaux et écrits manuscrits (lettres de demande d’emploi, correspondances privées, cahiers de liaison) de scripteurs ordinaires ou de futurs professionnels (futurs professeurs, futurs secrétaires) sont analysés à travers une grille précise d’évaluation, dont la reproductibilité permet d’éviter tout discours impressionniste sur la baisse du niveau orthographique en milieu non-scolaire. Les enseignants, qui jouent un grand rôle dans l’évaluation de la » faute » et dans la transmission de la norme n’ont pas été oubliés. L’ouvrage présente les résultats d’une enquête qui vise à rendre compte de leurs jugements sur les erreurs ainsi que de leurs, connaissances et de leur mise en pratique des rectifications proposées par le Conseil Supérieur de la Langue Française. Ainsi, les décideurs en matière orthographique, les instances qui régulent notre orthographe, comme tous ceux qui sont concernés par son devenir auront à disposition un ouvrage de référence, témoin à travers des milliers de lettres, de prises de notes, d’écrits individuels variés, de l’écriture réelle de notre époque.
La dictée, une pratique sociale emblématique
- Glottopol, revue de sociolinguistique, n° 26, Université de Rouen, laboratoire Dysola (http://glottopol.univ-rouen.fr/numero_26.html)
La faute de l’orthographe
- Arnaud Hoedt, Jérôme Piron, et Kevin Matagne pour les illustrations, Textuel, 2017
Arnaud Hoedt a étudié la linguistique et répond toujours « tu viens de le faire » à la question « est-ce que ça se dit ? ». Professeur de français à Bruxelles, il a participé à la rédaction des programmes de français en Belgique.
Jérôme Piron est professeur de religion catholique dans la même école. Il est monté pour la première fois sur scène dans le palais des Papes à Avignon pour le spectacle Cours d’Honneur de Jérôme Bel.
Kevin Matagne, designer et dessinateur de BD, a été laborantin dans une usine de chaux, restaurateur de meubles, programmeur, professeur de photo, églomiseur, doreur, réalisateur de films d’animation, sculpteur en image de synthèse…Le livre chez l’éditeur.
Un extrait du spectacle sur Youtube.
Zéro faute. L’orthographe, une passion française
- F. De Closets, Mille et une nuits, 2009, 321 p.
Libérons l’orthographe !
- M. Courberand, Chiflet & Cie, 2006, 126 p.
Commander dans une librairie en ligne
L’orthographe, un carcan ?
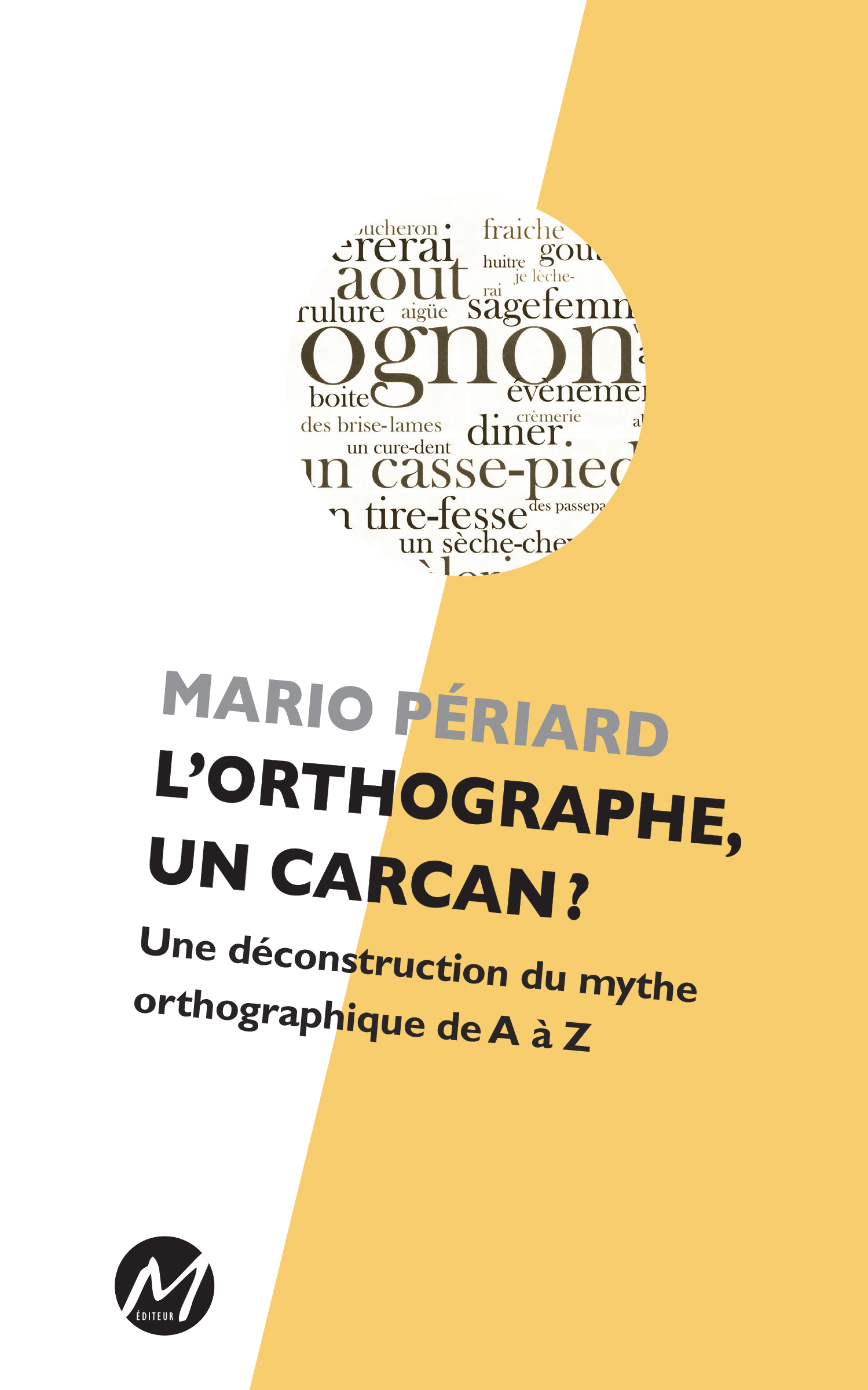 Périard Mario, 2018, L’orthographe, un carcan ? Editions M Editeurs
Périard Mario, 2018, L’orthographe, un carcan ? Editions M Editeurs
Une déconstruction du mythe orthographique de A à Z
« Combien de vies ratées pour quelques fautes d’orthographe ! », Roland Barthes
En effet, les personnes qui ne manient pas suffisamment bien les règles orthographiques en payeront le prix fort. Depuis longtemps au Québec, l’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans. Néanmoins, 53 % de la population adulte serait analphabète fonctionnelle. Quelle est donc la cause de ce problème ? Ne tiendrait-elle pas en bonne partie dans des règles surannées qui créent un fossé entre l’oral et l’écrit, un fossé qui s’élargit plus on descend dans la hiérarchie sociale ?
Si on vous disait que tout ce que vous croyez essentiel à l’écriture du français n’est qu’un ramassis d’idées préconçues auxquelles vous n’êtes pas tenues d’adhérer ? Au fond, qu’est-ce qui vous empêche d’écrire éléfan au lieu d’éléphant, ou de laisser les participes passés invariables ?
L’orthographe n’est-elle pas aujourd’hui une sorte de dogme, tant il est malaisé d’oser la contester ou la réformer sans se faire pratiquement accuser de sacrilège ?
Mario Périard s’attèle à déconstruire les principales idées reçues sur l’orthographe. Il vous convie à revisiter ces lieux communs mille fois répétés, ces prétextes pour maintenir le plus grand nombre dans un carcan normatif inaccessible, contradictoire, trop souvent illogique, farci d’exceptions à n’en plus finir, un carcan qui conforte les privilégiées de l’expression dans leur chasse gardée.
Culture et recherche, n° 124
- (articles de C. Gruaz et C. Martinez)
Ministère de la Culture et de la Communication, 2010-2011, 64 p.
Dictionnaires et manuels
Multidictionnaire de la langue française et La Nouvelle Grammaire en tableaux
- Desnoyers A., collaboration à Marie-Éva de VILLERS (2003, 2009, 2015), , Québec Amérique, Montréal, (4e, 5e et 6e édition).
http://www.multidictionnaire.com/produits/grammaire/
http://www.multidictionnaire.com/produits/multidictionnaire/
La nouvelle orthographe en pratique
- Dupriez D. Préface de C. Contant, De Boeck / Duculot, 2009, 227 p.
 À l’heure où les enseignants constatent une baisse généralisée du niveau orthographique de leurs élèves et où les principaux dictionnaires courants (Robert, Larousse, etc.) ont intégré une bonne partie des règles de la nouvelle orthographe, ce livre offre une mise au point sur ces rectifications de l’orthographe et les rend accessibles à tous par une présentation simplifiée.
À l’heure où les enseignants constatent une baisse généralisée du niveau orthographique de leurs élèves et où les principaux dictionnaires courants (Robert, Larousse, etc.) ont intégré une bonne partie des règles de la nouvelle orthographe, ce livre offre une mise au point sur ces rectifications de l’orthographe et les rend accessibles à tous par une présentation simplifiée.
L’approche pédagogique mettra à l’aide tout professionnel de la langue, journaliste, traducteur, professeur, étudiant ou parent amené à s’intéresser à la nouvelle orthographe, mais hésitant quant à la façon de l’appliquer.
Dans la première partie, l’ouvrage présente de manière claire et concise les raisons d’être de la nouvelle orthographe, en en expliquant l’historique, les motifs, les principes et en confrontant les points de vue des spécialistes qui se sont penchés sur la question.
La deuxième partie du livre, très concrète, se présente sous forme de tableaux d’accès rapide et de consultation facile, faisant de ce guide un véritable outil de travail, qui deviendra très vite un indispensable à avoir sous la main.
Commander sur le site de l’éditeur
Cahiers de lexicologie n°97, « Dictionnaires et orthographe »
- C. Jacquet-Pfau & M. Mathieu-Colas (dir.) Éditions classiques Garnier, 2010, 249 p.
 Les dictionnaires entretiennent une relation privilégiée avec l’orthographe : non seulement le système des entrées met en vedette les graphies, mais ces graphies elles-mêmes font souvent l’objet de commentaires explicites. Par-delà leur diversité, quelle connaissance de l’orthographe les dictionnaires apportent-ils ? Quelle est leur cohérence ? Quel parcours historique permettent-ils de retracer ? Comment abordent-ils les propositions de réforme ? Autant de questions explorées dans ce numéro.
Les dictionnaires entretiennent une relation privilégiée avec l’orthographe : non seulement le système des entrées met en vedette les graphies, mais ces graphies elles-mêmes font souvent l’objet de commentaires explicites. Par-delà leur diversité, quelle connaissance de l’orthographe les dictionnaires apportent-ils ? Quelle est leur cohérence ? Quel parcours historique permettent-ils de retracer ? Comment abordent-ils les propositions de réforme ? Autant de questions explorées dans ce numéro.
Sommaire du numéro
Vérifiez votre orthographe. Votre correcteur de poche. 64 000 mots
- D. Le Fur, Le Robert, 2008, 512 p.
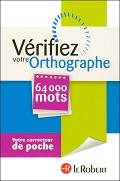 La réponse à toutes vos questions sur l’orthographe et la présentation d’un mot.
La réponse à toutes vos questions sur l’orthographe et la présentation d’un mot.
Les graphies recommandées par la réforme de l’orthographe, les recommandations officielles, les marques déposées, la prononciation des mots rares ou difficiles, et des annexes : les suffixes et préfixes, les noms d’habitants, l’accord du participe passé, les tableaux de conjugaison.
Un compagnon indispensable pour l’expression écrite et les jeux de lettres !
Commander sur le site de l’éditeur
Le Ramat européen de la typographie
- A. Ramat & R. Muller, De Champlain, 2009, 224 p.
 Les sigles doivent-ils prendre la marque du pluriel ? Quels types de guillemets employer, quand et comment ? Dans quel cas écrire davantage ? d’avantage ? Comment commencer un message électronique ? Par quelle formule de politesse le terminer ?
Les sigles doivent-ils prendre la marque du pluriel ? Quels types de guillemets employer, quand et comment ? Dans quel cas écrire davantage ? d’avantage ? Comment commencer un message électronique ? Par quelle formule de politesse le terminer ?
Le Ramat européen de la typographie présente les règles typographiques en usage, sert d’aide-mémoire orthographique, donne des conseils pour bien présenter ses écrits. Il s’adresse aussi bien à celles et ceux chargés de la mise en pages ou de la relecture de documents qu’à toute personne qui écrit des messages électroniques, des rapports ou des poèmes…
Commander dans une librairie en ligne
Manuel d’orthographe pour le français contemporain
- C. Skupien Dekens, A. Kamber & M. Dubois, Alphil, 2011, 196 p.
 Associant explications théoriques, exercices pratiques et listes de mots, ce manuel s’adresse à des apprenants du français de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). Il se compose de deux parties : l’une est consacrée aux règles d’orthographe grammaticale, l’autre à l’orthographe d’usage.
Associant explications théoriques, exercices pratiques et listes de mots, ce manuel s’adresse à des apprenants du français de niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). Il se compose de deux parties : l’une est consacrée aux règles d’orthographe grammaticale, l’autre à l’orthographe d’usage.
Dans la première partie, les auteurs abordent tous les grands chapitres de l’orthographe grammaticale (pluriel et féminin des noms et des adjectifs, accord du participe passé, etc.). Évitant au maximum les listes d’exceptions, ils cherchent à donner aux apprenants des explications à valeur générale. Le lien entre code phonique et code graphique (entend-on ou non une distinction de genre ou de nombre, par exemple) est mis en évidence pour expliquer les règles et les systématiser.
Les mots présentés dans la partie dédiée à l’orthographe d’usage ont été sélectionnés selon un critère de fréquence : il s’agit des 2000 mots les plus courants dans un corpus journalistique. Les unités lexicales sont classées en fonction du lien entre le code oral et le code écrit ; de cette manière, les auteurs veulent mettre en évidence des correspondances régulières entre phonèmes et graphèmes. Dans les exercices d’orthographe d’usage, le recours à l’alphabet phonétique international (API) permet de tenir compte du rôle important du code oral pour l’acquisition de la graphie.
Tirés d’un corpus journalistique de la première décennie du XXIe siècle, tous les exemples et toutes les phrases des exercices de ce manuel sont authentiques.
Commander sur le site de l’éditeur
Mettre au féminin. Guide de féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre
- Sous la direction de M. Lenoble-Pinson, Ministère de la Communauté française de Belgique, 2e édition, 2005
 En Belgique, le décret de la Communauté française du 21 juin 1993 impose la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre dans les actes officiels (décrets, règlements, circulaires, etc.), dans les documents émanant des autorités administratives ainsi que dans la publication des offres et des demandes d’emploi.
En Belgique, le décret de la Communauté française du 21 juin 1993 impose la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre dans les actes officiels (décrets, règlements, circulaires, etc.), dans les documents émanant des autorités administratives ainsi que dans la publication des offres et des demandes d’emploi.
Le Guide, qui compte 1 619 entrées classées par ordre alphabétique, a d’abord été édité pour les fonctionnaires et s’adresse aujourd’hui à tous ceux qui écrivent en français.
Comme dans Femme, j’écris ton nom, guide paru en France en 1999, les entrées sont écrites en orthographe rectifiée, recommandée par l’Académie française. Suivent les graphies traditionnelles. Aucune des deux graphies, ni la nouvelle ni l’ancienne, ne peut être tenue pour fautive.
Ex. : (masculin) flutiste ou flûtiste / (féminin) flutiste ou flûtiste
Les féminins en –eure s’implantent en Belgique et en France (ils sont déjà intégrés dans le guide français Femme, j’écris ton nom). Ils assurent la visibilité des femmes, en particulier lorsque les noms sont accompagnés de déterminants élidés ou pluriels (l’auteure, les auteures vs l’auteur, les auteurs). Le –e est purement graphique et ne doit pas plus s’entendre à l’oral que dans contractuelle ou supérieure. La première forme féminine donnée suit les règles traditionnelles, la seconde s’est introduite dans l’usage. L’usager a le choix d’utiliser les formes féminines traditionnelles en –eur ou les formes nouvelles en –eure.
Ex. : (masculin) auteur / (féminin) auteur, auteure
Les particularités lexicales du français de Belgique sont écrites en caractères italiques.
Ex. : (masculin) kinésiste / (féminin) kinésiste
Consulter l’ouvrage sur le site du Service de la langue française
Le participe passé autrement. Protocole d’accord, exercices et corrigés
- M. Wilmet, Duculot, coll. Entre guillemets, 1999, 130 p.
 Un linguiste d’aujourd’hui affronte l’éternel pont aux ânes de la grammaire scolaire : l’accord du participe passé. Cet ouvrage aurait pu s’intituler « le participe passé sans faute » (car il enseigne une méthode à la fois rapide, sûre et rigoureuse pour parvenir à l’orthographe normativement requise) mais plus encore « le participe passé intelligemment ». Son ambition, au-delà du premier objectif pratique, est en effet d’exercer la réflexion, le sens de la langue et la perception des nuances.
Un linguiste d’aujourd’hui affronte l’éternel pont aux ânes de la grammaire scolaire : l’accord du participe passé. Cet ouvrage aurait pu s’intituler « le participe passé sans faute » (car il enseigne une méthode à la fois rapide, sûre et rigoureuse pour parvenir à l’orthographe normativement requise) mais plus encore « le participe passé intelligemment ». Son ambition, au-delà du premier objectif pratique, est en effet d’exercer la réflexion, le sens de la langue et la perception des nuances.
Ainsi, le temps économisé à l’école va de pair avec un authentique progrès de la compétence en français.
Commander sur le site de l’éditeur
Accordez vos participes
- Accordez vos participes, M. Sommant, Albin Michel, 2004, 154 p.
Commander dans une librairie en ligne
Dictionnaire synchronique des familles dérivationnelles de mots français
- DISFA. sous la direction de C. Gruaz, rédaction de C. Gruaz et R. Honvault, avec la collaboration de C. Dejean, A. Fragoso, J. Honvault, A. Meyer, S. Skippon,Lambert-Lucas, 2008, 1300 p.
Commander sur le site de l’éditeur
Homonymes en exercices
- Georges Farid, Éditions nouvelles, 2012.
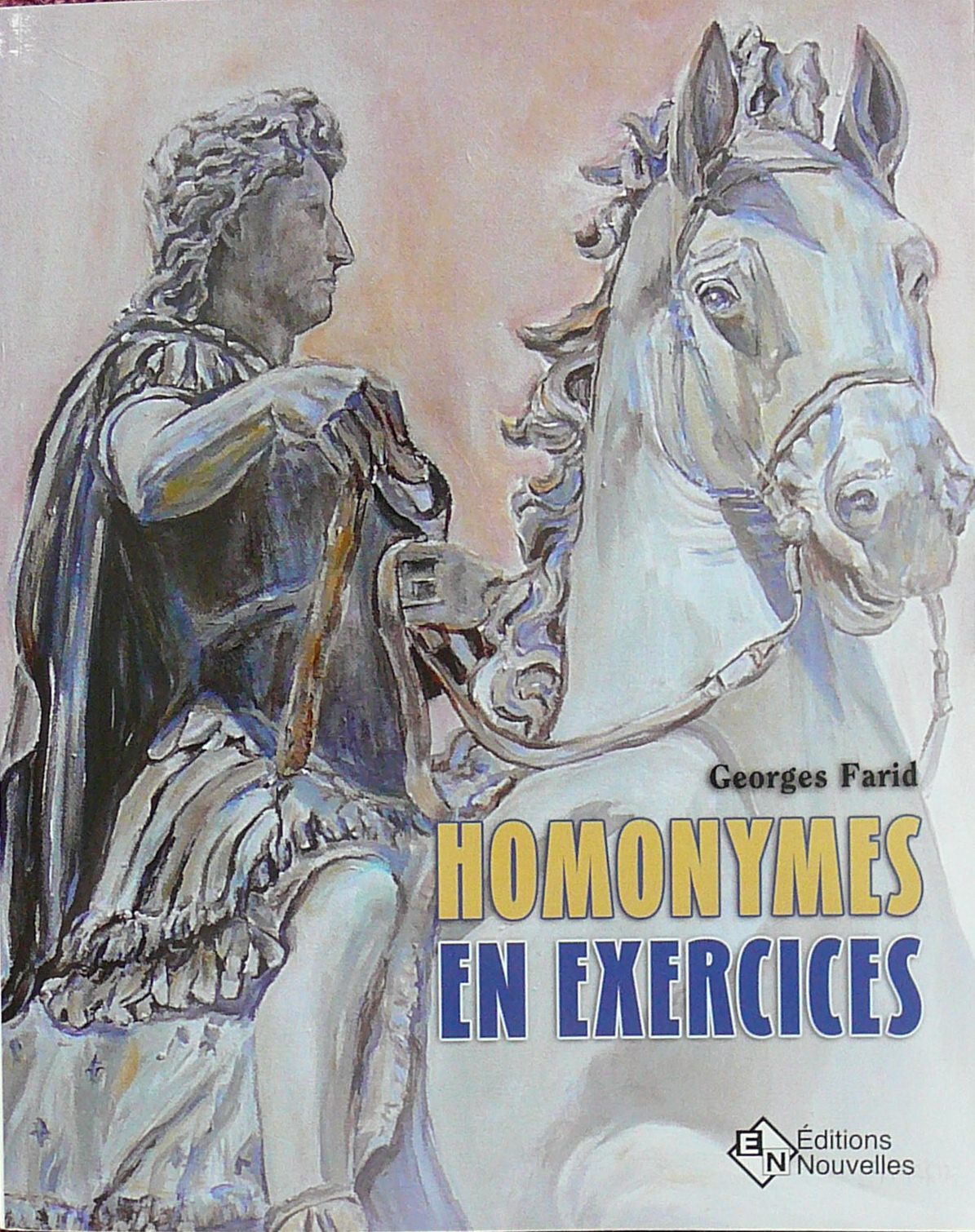 |
Professeur à l’Université du Québec en Outaouais, Georges Farid, docteur en linguistique de l’université Paris V, ajoute, à sa dernière publication Mieux comprendre le participe passé, cet ouvrage sur les homonymes qui vous aidera à écrire correctement. Fidèle compagnon du dictionnaire, ce livre contribuera efficacement à résoudre les difficultés orthographiques et grammaticales reliées aux homonymes. C’est un outil indispensable et de consultation aisée. Grâce à des stratégies élaborées minutieusement et illustrées par des centaines d’exemples, d’exercices et de leur corrigé, vous ne confondrez plus des homonymes tels que « ce, ceux, se ; ces, ses , c’est, s’est ; du, dû, due, dues, dus, dut ; en fin, enfin ; là, la, l’as, las ; leur, leurre, leurs ; on, ont ; ou, où ; parce que, par ce que ; quel, quels, quelle, quelles, qu’elle, qu’elles ; quelque, quel que ; qui la, qui l’a, qu’il a, qu’il la ; quoi que, quoique ; voir, voire… ». HOMONYMES EN EXERCICES est un livre pratique destiné aux niveaux secondaire, collégial et universitaire, et à toute personne soucieuse d’améliorer la qualité de son français écrit.Commander dans une librairie en ligne |
Nouvelle orthographe. La liste simplifiée
- C. Contant De Champlain S. F., 2010, 216 p.
 Nouvelle orthographe pour tous. La liste simplifiée des mots de la nouvelle orthographe donne accès en un coup d’œil aux changements apportés à l’orthographe.
Nouvelle orthographe pour tous. La liste simplifiée des mots de la nouvelle orthographe donne accès en un coup d’œil aux changements apportés à l’orthographe.
Consultation rapide et facile. Liste alphabétique. Changements indiqués de façon très visible. Rappel des règles au bas de chaque page. Règles présentées avec des exemples simples.
La nouvelle orthographe est en vigueur. Elle est applicable dans toute la francophonie.
Ce livre permet de vérifier rapidement chaque mot touché par les rectifications de l’orthographe du français et d’en comprendre le changement.
Ce livre est une version simplifiée du Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandée.
Commander dans une librairie en ligne
Guide de poche orthographe
- F. Rullier-Theuret & al.Larousse, 2005, 476 p.
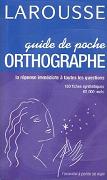
Le guide pratique et efficace en couleurs pour répondre à toutes les questions d’orthographe et mémoriser les règles essentielles.
150 fiches claires et attrayantes, classées par ordre alphabétique, qui recensent toutes les difficultés : accords, pluriels des noms et des adjectifs, mots composés, ponctuation, homophones, familles de mots…
Un index complet des notions abordées dans les fiches.
Un vérificateur d’orthographe pour savoir écrire sans fautes 65 000 mots du français.
Des remarques, conseils et astuces en plus des règles classiques pour acquérir les bons réflexes en orthographe.
Les fiches orthographiques ont été rédigées par Françoise Rullier-Theuret, membre de ÉROFA.
Commander dans une librairie en ligne
Dictionnaire d’orthographe et de difficultés du français
-
- Dirigé par D. Le Fur, Le Robert, collection Les usuels, 2010, 1144 p.
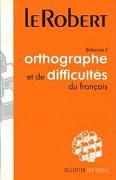 Ce nouvel ouvrage de la collection des usuels du Robert est le bienvenu au moment où la question de l’orthographe redevient d’actualité.
Ce nouvel ouvrage de la collection des usuels du Robert est le bienvenu au moment où la question de l’orthographe redevient d’actualité.
Le sujet est traité de manière particulièrement complète si l’on en juge par le contenu de chacune des sept parties :
1. Le dictionnaire proprement dit : il rassemble près de 84 000 mots. Ce n’est pas une simple liste car il contient de nombreuses explications sur des irrégularités et particularités orthographiques, sources de bien des confusions et erreurs.
2. Grammaire et usage : 27 chapitres présentent les grandes catégories de l’orthographe grammaticale, générales tels que les adjectifs qualificatifs ou les adverbes, ou plus particulières tels que les chiffres et les nombres.
3. Tableaux de conjugaison : 74 verbes modèles représentent la conjugaison de tous les verbes. Les modifications préconisées par les Rectifications de 1990 sont systématiquement indiquées.
4. Articles linguistiques : les processus de formation des mots (dérivation, composition, néologie…), le rapport entre l’oral et l’écrit (élision et apostrophes, liaisons et enchainements…) montrent que derrière les régularités transparait une continuelle évolution.
5. Figures de style : elles permettent de prendre quelque distance avec les règles orthographiques et grammaticales pour jouer avec les mots et les agencer de manière originale. Des extraits de la littérature classique et moderne illustrent les principales figures de style.
6. Réformes de l’orthographe : nombreuses ont été les réformes élaborées depuis le XVIe siècle jusqu’aux Rectifications de l’orthographe de 1990 et les études en cours. De longs développements consacrés aux principales d’entre elles remettent en perspective l’ambition et la portée de Rectifications de 1990.
7. Guide typographique : les spécialistes de l’écrit trouveront les règles concernant la ponctuation, la formalisation des abréviations, l’usage des majuscules et des chiffres, la coupure des mots, etc.
On ne peut qu’être pleinement d’accord avec D. Le Fur, directrice éditoriale de l’ouvrage, lorsqu’elle souligne dans la préface que « cet ouvrage s’adresse (…) aux amoureux du français, curieux des grands procédés de création lexicale et de l’évolution de l’orthographe au fil des siècles, au gré de l’usage et des tentatives de réforme ».
NB. Les parties « Articles linguistiques » et « Réformes de l’orthographe » (qui contient une référence aux études de ÉROFA) ont été rédigées par Claude Gruaz, président de ÉROFA.
Commander dans une librairie en ligne
Grand vadémécum de l’orthographe moderne recommandé. Cinq millepattes sur un nénufar
- C. Contant, De Champlain S. F., 2009, 256 p.
 La liste la plus complète de graphies rénovées.
La liste la plus complète de graphies rénovées.
Vous doutez de l’orthographe moderne d’un mot ? Consultez la liste en quelques secondes. Familiarisez-vous avec les règles.
L’orthographe moderne et ses nouvelles règles suppriment des anomalies et vous libèreront de plusieurs hésitations que vous éprouvez en situation d’écriture. La nouvelle orthographe est une invitation à écrire de façon plus régulière. Ouvrez ce livre pour vous en convaincre.
Les rectifications de l’orthographe du français sont officielles, sont valables dans toute la francophonie.
La nouvelle orthographe apporte aux rèles du français plus de cohérence et privilégie une francisation croissante. Ces rectifications actuellement en vigueur font du bien au français écrit, en mettant en place un petit toilettage sage et limité devenu nécessaire. Après tout, l’orthographe est une invention humaine, elle peut donc être améliorée. La nouvelle orthographe rend service à la langue française écrite, en favorisant son modernisme. Employez-la dès aujourd’hui !
Commander dans une librairie en ligne
Connaitre et maitriser la nouvelle orthographe
- C. Contant & R. Muller, 2e édition, De Champlain S. F., 2009, 144 p.
 |
Les rectifications de l’orthographe permettent une plus grande cohérence dans la manière d’écrire, et viennent chasser des irrégularités peu justifiables. Elles sont faciles à maitriser – les rectifications ont bien pour but de simplifier l’orthographe en la systématisant, sans bouleverser nos habitudes -, mais il n’est pas moins nécessaire de bien les connaitre afin de pouvoir les appliquer. Ce livre, qui se présente comme un guide pratique incluant des exercices détaillés, a précisément été conçu pour vous livrer une foule d’informations utiles, répondre aux questions que vous vous posez et vous familiariser avec la nouvelle orthographe. Indispensable pour se mettre à jour !Commander dans une librairie en ligne |
La Nouvelle Orthographe expliquée à tous
- Dominique Dupriez. Albin Michel / RTL. 128 p.
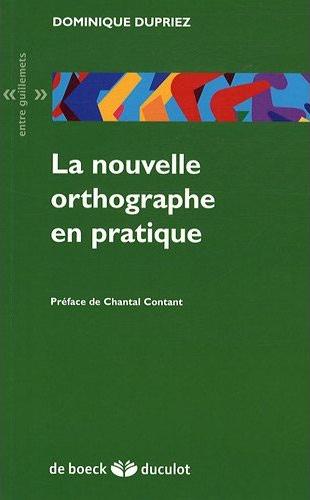
« Ognon », « weekend », « mamie », la réforme de l’orthographe n’a pas fini de nous surprendre ! Oubliez les « extra-terrestres » et les « croque-monsieur » ; bienvenue aux « extraterrestres » et aux « croquemonsieurs ». Disparition partielle de l’accent circonflexe sur le « i » et le « u », et simplification de quelque 2400 mots !
Pas de panique, ce livre va vous sauver ! Simple, efficace, ludique, la nouvelle orthographe devient un jeu d’enfant. Pour en finir définitivement avec les fautes d’orthographe, pour les petits et pour les grands !
L’Orthographe des dictionnaires français – La construction de la norme graphique par les lexicographes
- Camille Martinez, Honoré Champion, 2012, 648 p.
| L’orthographe du français est en perpétuelle évolution. En tant que norme sociale, elle s’incarne depuis à peine un siècle et demi dans les dictionnaires généraux monolingues les plus répandus. Ces dictionnaires, qui se succèdent dans le paysage lexicographique, sont investis d’un pouvoir décisionnel. En tant que norme graphique dont rendent compte les dictionnaires, l’orthographe n’est pas immuable. Chaque lexicographe possède en effet une part de choix dans les graphies des articles qu’il rédige, ce qui a conduit des linguistes à relever des milliers de variantes graphiques dans des ouvrages parus avant 1997. De plus, les éditions successives d’un même dictionnaire apportent chacune leur lot de changements orthographiques et de retouches dans le traitement lexicographique de l’orthographe. Pour circonscrire la transformation de la norme graphique, nous avons comparé entre eux les Petit Larousse 1997 à 2011 et les Petit Robert de la même période. La comparaison de ces trente ouvrages a impliqué la mise en œuvre d’une grille de lecture dont les fruits portent sur l’orthographe. Une description classificatoire des 3 80 0 changements graphiques relevés au fil des éditions met en relief les contours de l’évolution de notre orthographe. L’examen de ces données cède alors le pas à un questionnement sur la place du dictionnaire dans notre société et à une analyse de la responsabilité des lexicographes dans le changement linguistique. |
Petit dico des changements orthographiques récents
- Camille Martinez, Zeugmo Éditions
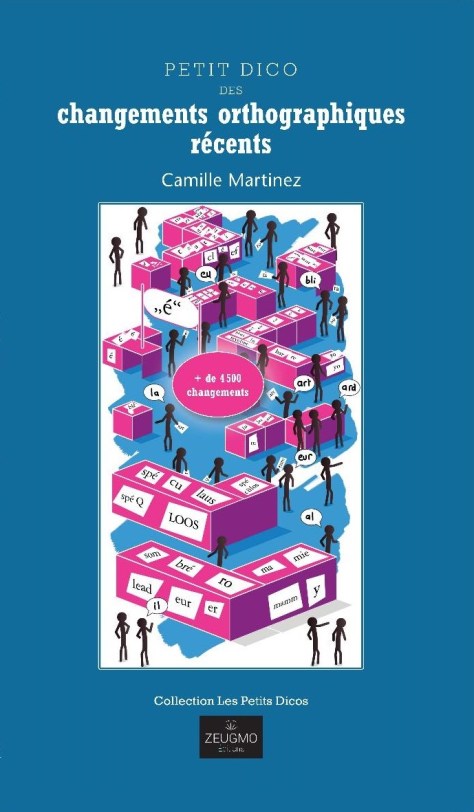 |
La français évolue en permanence. Pas seulement parce que de nouveaux mots apparaissent ou disparaissent, mais aussi parce que la forme des mots change. Autrefois, les changements orthographiques des dictionnaires étaient publiés par les correcteurs. Il est temps de renouer avec cette pratique… |